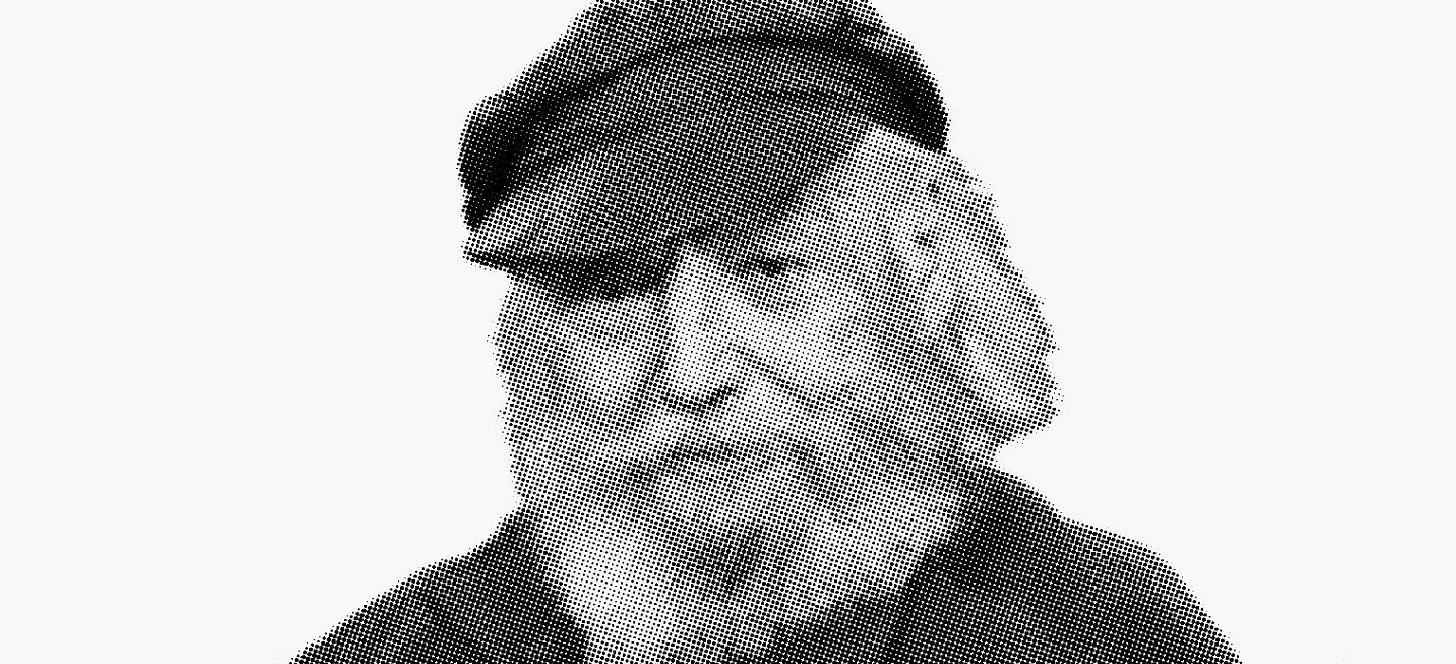On New Work in Higher Ed
new work dans l'enseignement supérieur
Alors que j'observe, applique et soutiens fermement la révolution en cours qui transforme les lieux de travail à travers l'Europe et au-delà, je suis toujours frappé par le fait que l'enseignement supérieur reste profondément ancré dans les pratiques de l'ère industrielle. Nous croyons et disons que nous préparons les étudiants à des carrières flexibles et motivées dans des environnements agiles et des entreprises hybride, alors que nous leur enseignons généralement dans des environnements rigides et standardisés.
Je suis un fan du travail de Christoph Magnussen, que ce soit sur Youtube, sur son podcast ou dans le livre qui en a résulté, « On the Way to New Work ». J'ai beaucoup appris de ses approches et j'ai souvent appliqué ses idées au secteur de l'éducation.
Réagir à l'honnêteté
Soyons honnêtes ! Le monde dans lequel nous vivons et travaillons a considérablement changé au cours des deux dernières décennies, tant sur le plan culturel que technologique. Un changement perturbateur qui ne fera que s'accélérer, sous l'effet des nouvelles technologies, des insécurités politiques, du changement climatique et de tous les autres défis majeurs auxquels nous pouvons penser. Vous vous souvenez peut-être de la façon dont la pandémie de 2020 a profondément modifié notre vie quotidienne et notre travail, même si ce n'est que pour une courte période, avant de revenir à nos anciennes façons de faire, destructrices mais réconfortantes. Dans le même temps, les limites de la croissance perpétuelle annoncée deviennent de plus en plus évidentes et physiquement palpables pour un nombre importante de personnes.
Restons honnêtes, rien de tout cela n'arrive sans avertissement ! Frithjof Bergmann, philosophe germano-américain, l'a prévu au début des années 1980, en évoquant ce qu'il a appelé quatre tsunamis :
le fossé qui ne cesse de se creuser entre une richesse obscène et une pauvreté effroyable
le gaspillage des ressources naturelles
la destruction progressive du climat
la destruction de la culture
Pour Bergmann, les causes de ces quatre tsunamis sont à rechercher dans l'évolution erronée de notre conception du travail et de l'économie. Selon lui, le travail est malheureusement devenu quelque chose qui affaiblit les gens et les rend malades. Il a vu dans le mouvement du “new work”, qu'il a fondé, l'occasion d'inverser cette évolution et de rendre les gens plus autonomes.
Alors que le concept de “new work” est souvent utilisé à tort pour « seulement » créer un environnement de travail encore plus efficace aujourd'hui, son application originale à l'enseignement supérieur pourrait transformer fondamentalement notre façon d'apprendre et de conceptualiser l'expérience universitaire.
Heureusement, cette transformation n'est pas seulement théorique, elle se produit déjà dans des poches d'innovation à travers le paysage de l'enseignement supérieur européen.
Moins d'heures, plus d'impact
L’accord de Bologne a normalisé l'enseignement supérieur européen autour des crédits ECTS, mesurant essentiellement l'apprentissage en unités de temps. D'autre part, le “new work” se concentre sur les résultats significatifs plutôt que sur les heures consacrées aux tâches. Et si nous appliquions ce principe à l'enseignement supérieur ?
Dans cette optique, imaginons que l'on remplace les cours traditionnels par des « projets d'impact » dans le cadre desquels les étudiants relèvent des défis du monde réel tout en démontrant qu'ils maîtrisent des compétences essentielles. La Rotterdam School of Management a été la première à adopter une telle approche avec ses projets de « gestion vivante », dans le cadre desquels les étudiants travaillent directement avec des organisations néerlandaises pour résoudre des problèmes authentiques tout en développant une compréhension du contexte.
De même, l'université d'Aalborg au Danemark offre un autre exemple avec son modèle d'apprentissage basé sur les problèmes, organisant des programmes entiers autour de défis authentiques plutôt que de sujets académiques. Les étudiants sont reconnus non pas en assistant à des cours magistraux, mais en créant des solutions viables à des problèmes sociétaux complexes.
La question fondamentale n'est plus de savoir si l'étudiant a suivi le nombre d'heures requis, mais plutôt de savoir quel changement significatif il a créé. Cette approche n'est pas seulement pédagogique, elle prépare les étudiants à des lieux de travail de plus en plus organisés autour de projets agiles plutôt que de postes.
Les espaces physiques comme accélérateurs d'apprentissage
J'ai toujours souligné l'importance de l'« espace » dans lequel le (nouveau) travail s'effectue. En s'appuyant sur les observations de Magnussen et sur sa collaboration avec des entreprises allemandes avant-gardistes, il souligne la manière dont les environnements physiques permettent ou limitent les nouvelles pratiques de travail. Transposer cette idée aux espaces universitaires traditionnels, aux amphithéâtres avec des sièges fixes, aux bibliothèques conçues pour l'étude individuelle et silencieuse, reflète certainement plus que des hypothèses dépassées sur la façon dont l'apprentissage se déroule !
La TU Delft, aux Pays-Bas, et la D-School de Stanford ont repensé leur architecture et leurs installations d'ingénierie en fonction du travail collaboratif. Leurs laboratoires sont équipés de meubles mobiles, de murs transparents et de nombreux matériaux de prototypage. Ces espaces ne se contentent pas d'accueillir l'apprentissage par projet : ils encouragent activement la collaboration interdisciplinaire qui est au cœur des modèles d'innovation de rupture.
L'école Kaospilot au Danemark offre un autre exemple instructif avec ses espaces entièrement reconfigurables conçus explicitement pour les processus créatifs de résolution de problèmes.
La création de ces environnements ne nécessite pas toujours des investissements massifs. Les salles de classe traditionnelles peuvent être facilement transformées en « studios d'apprentissage » en y ajoutant simplement des surfaces de présentation multiples, des tableaux blancs portables et une disposition flexible des sièges.
Lorsque les étudiants peuvent physiquement réorganiser leur environnement pour s'adapter aux différentes étapes de l'innovation, ils intériorisent la pensée flexible essentielle aux nouveaux contextes de travail contemporains. S'ils sont enfermés dans une cage académique, ils auront du mal à trouver leur place dans l'agilité. Nous sommes malheureusement encore des créatures d'habitudes.
Infrastructure numérique pour les communautés d'apprentissage
Le “new work” met l'accent sur des communautés dynamiques organisées autour d'un objectif commun plutôt que sur des structures hiérarchiques. Les outils numériques peuvent fortement favoriser ces formes d'organisation fluides, mais uniquement lorsqu'ils sont déployés de manière réfléchie et qu'ils sont centrés sur une connexion humaine sincère.
L'enseignement supérieur devrait tirer parti d'approches similaires en créant ce que j'appelle des « Learning Commons », des environnements numériques ou hybrides où la création de connaissances s'effectue au-delà des frontières traditionnelles.
L'Institut royal de technologie KTH, en Suède, propose un modèle prometteur avec son Open Lab, une plateforme où les communautés se forment autour de défis sociétaux émergents plutôt que de disciplines académiques prédéterminées. Ces plateformes reconnaissent que l'apprentissage se fait par la contribution à des bases de connaissances évolutives, et non par la simple consommation d'un contenu établi.
L'idée clé de cette approche est que la technologie doit renforcer les liens communautaires plutôt qu'isoler les apprenants. Lorsque les outils numériques relient les étudiants à d'authentiques communautés de pratique, ils préparent les diplômés à des lieux de travail contemporains et agiles où la collaboration se fait au-delà des cultures, des disciplines et des frontières organisationnelles.
Des diplômes fixes aux parcours d'apprentissage
De manière peut-être plus radicale, le “new work” remet en question la notion de parcours professionnel fixe avec des qualifications prédéterminées. Le livre de Magnussen décrit comment les principales organisations allemandes se concentrent sur le développement continu des compétences plutôt que sur des descriptions de poste statiques.
Comme vous le savez certainement, je suis un fervent partisan des « micro-crédits » : des unités d'apprentissage plus petites et superposables qui permettent de personnaliser les parcours éducatifs. Le programme de l'université de Padoue, qui permet aux étudiants d'accumuler des titres dans plusieurs établissements européens, illustre cette approche, en créant des parcours d'apprentissage flexibles qui tiennent compte des diverses trajectoires professionnelles.
Le système très avancé de l'Université ouverte finlandaise illustre un autre aspect de ce changement avec son approche de l'accessibilité tout au long de la vie. Toute personne peut accéder à des cours universitaires tout au long de sa vie, ce qui reflète l'engagement de la Finlande à considérer l'éducation comme un parcours continu plutôt que comme une expérience ponctuelle. Ce modèle radical reconnaît que l'apprentissage peut et doit se faire à différents stades de la vie et par différentes voies. C'est précisément la flexibilité que les nouveaux environnements de travail exigent et renforcent.
Le corps professoral en tant que concepteur et connecteur d'apprentissage
Le paradigme du “new work” transforme fondamentalement les rôles de leadership, qui passent d'un rôle de commandement et de contrôle à un rôle d'habilitation et de connexion. De même, les enseignants doivent passer du statut d'experts en contenu qui délivrent des connaissances à celui d'architectes de l'apprentissage qui conçoivent des expériences transformatrices.
L'initiative « Humboldt Reloaded » de l'université de Humboldt illustre ce changement. Les professeurs travaillent avec des organisations civiques et culturelles de Berlin pour créer des expériences d'apprentissage où les étudiants s'attaquent à des problèmes concrets. Les professeurs servent de mentors et de connecteurs plutôt que de conférenciers, aidant les étudiants à résoudre des problèmes complexes tout en construisant des réseaux professionnels : L'université en tant qu'espace de découverte intégrée.
Cette approche peu orthodoxe nécessite de nouveaux modèles de développement du corps enseignant. Nous devons promouvoir des cours d'amélioration de l'enseignement qui investissent massivement dans l'aide aux enseignants pour la refonte de leurs cours autour des principes de l'apprentissage actif. Les écoles, ainsi que les enseignants, doivent reconnaître que l'expertise pédagogique est aussi précieuse (si ce n'est plus) que les connaissances disciplinaires.
Je suis convaincu que l'avenir appartient aux institutions qui préparent les étudiants non seulement avec des connaissances, mais aussi avec la capacité de s'épanouir dans des environnements en perpétuel changement. En intégrant les principes du “new work” dans nos modèles éducatifs, nous pouvons créer des expériences d'apprentissage qui sont à la fois plus efficaces et plus en phase avec le monde que nos diplômés contribueront à construire : un monde où la collaboration, la durabilité et la dignité humaine façonnent l'innovation technologique et organisationnelle.
Quelle mesure allez-vous prendre pour entamer cette transformation dans votre établissement?